
♥ ♥ ♥
L’auteur :
John Williams (1922-1994), né au Texas a étudié au Colorado et obtenu son doctorat dans le Missouri où il a fait ses premiers pas de professeur. Après avoir servi dans l’armée de l’air de 1942 à 1945, il a enseigné la littérature et l’art d’écrire pendant trente ans à l’université de Denver. Il est l’auteur de deux recueils de poèmes, d’une anthologie sur la poésie anglaise de la Renaissance et de quatre romans, dont Stoner, publié en 1965.
L’histoire :
Né pauvre dans une ferme du Missouri en 1891, le jeune William Stoner est envoyé à l’université par son père – et au prix de quels sacrifices –, pour y étudier l’agronomie. Délaissant peu à peu ses cours de traitement des sols, ce garçon solitaire découvre les auteurs, la poésie et le monde de l’esprit.
Présentation d’Anna Gavalda :
C’est en lisant une interview de Colum McCann parue dans le quotidien anglais The Guardian il y a quelques années que j’ai découvert Stoner de John Williams. McCann affirmait que ce roman, publié en 1965, était un grand oublié de la littérature américaine, ajoutait qu’il en avait déjà acheté plus d’une cinquantaine d’exemplaires pour l’offrir à ses amis et que c’était un texte qui touchait autant les écrivains que les simples lecteurs. Cette précision m’avait mis la puce à l’oreille et je m’étais empressée de le lire. De le lire, de l’aimer et d’avoir envie de le partager à mon tour. Hélas, il n’avait jamais été édité en français. La suite est simple : j’ai demandé à mon éditeur d’en acquérir les droits, ai vaguement cherché un traducteur patenté et ai fini par m’avouer ce que je savais déjà, à savoir que William Stoner, c’était moi, et que c’était à moi de m’y coller. Pour le meilleur, pour ce « vertige de l’orpailleur » évoqué dans le chapitre IX – expression qui n’est pas dans le texte original et que je me sais gré d’avoir inventée – ceux qui liront jugeront, et pour le pire: des heures et des heures passées arc-boutée sur un bout de phrase que je comprenais, que je « voyais » mentalement, mais qu’il m’était impossible de traduire… Pourquoi tant d’enthousiasme et tant de peines ? Je ne sais pas. Voilà un roman qui n’a rien de spectaculaire. Le récit d’une vie âpre, austère, une vie de prof, une vie passée sous silence et tout entière consacrée à la littérature, bref pas très sexy, j’en conviens et n’en espère aucun miracle, mais je suis bien heureuse d’avoir été au bout de ce projet. D’une part parce qu’il m’a beaucoup appris sur « le métier », toutes ces histoires de légitimité, de liberté, de respect dû à une voix plutôt qu’à une langue m’ont passionnée, d’autre part parce c’est un roman qui ne s’adresse pas aux gens qui aiment lire, mais aux êtres humains qui ont besoin de lire. Or, avoir besoin de lire n’est pas forcément un atout, ce peut être, même, souvent, un handicap. Se dire que la vie, bah… tout compte fait, n’est pas si importante que ça et que les livres pareront à ses manquements, c’est prendre le risque, souvent, de passer à côté. William Stoner donne cette impression de gâchis. D’ailleurs c’est une question qui le hante au moment de sa mort : parce que j’ai aimé lire plus que tout, j’ai déçu mes parents, perdu des amis, abîmé ma famille, renoncé à ma carrière et eu peur du bonheur, ai-je raté ma vie ?
Quelques battements de cils plus tard, il y répond et, en essayant de le servir le mieux possible, j’y ai répondu aussi. Car en vérité, et nous pouvons l’avouer, que nos vies soient ratées ou pas nous importe moins que cette question posée par un professeur à ce jeune homme gauche, fruste et solitaire qui n’a encore jamais mis les pieds dans une bibliothèque et qui deviendra mon héros :
« M.Stoner, M.Shakespeare s’adresse à vous à travers trois siècles. L’entendez-vous ? »
Anna Gavalda
Ce que j’ai aimé :
Stoner est un roman brut, sans fioritures, qui va droit à l’essentiel, bien campé dans un style direct et incisif. Il évoque la vie d’un homme ni plus brillant, ni plus intelligent qu’un autre, un homme qui se laisse porter par les évènements sans songer à résister et assume jusqu’à la fin l’implication de ses choix. Un homme ordinaire qui va placer la littérature au centre de son univers, parce qu’elle seule a ce pouvoir rédempteur et consolateur, insufflant ainsi aux vies qui la frôlent un semblant d’éternité et de bonheur.
« Il comprenait le rôle de la grammaire et percevait comment, par sa logique même, elle permettait, en structurant un langage, de servir la pensée humaine. De même, en préparant de simples exercices de rédaction, il était frappé par le pouvoir des mots, par leur beauté, et avait hâte de se lancer enfin pour pouvoir partager toutes ces découvertes avec ses étudiants. » (p. 39)
L’amour même sera souffrance pour Stoner, marié à une femme névrosée, profondément instable, il vivra une passion tumultueuse mais sans avenir avec une jeune étudiante. Sa femme lui offrira une enfant, Grace, qui aurait peut-être pu le sauver, mais qui s'éloignera inéluctablement, poussée par cette mère au mal-être cruel et assassin.
« Quand il était très jeune William Stoner pensait que l’amour était une sorte d’absolu auquel on avait accès si l’on avait de la chance. En vieillissant il avait décidé que c’était plutôt la terre promise d’une fausse religion qu’il était bon ton de considérer avec un scepticisme amusé ou un mépris indulgent, voire une mélancolie un peu douloureuse. Mais maintenant qu’il était arrivé à mi-parcours, il commençait à comprendre que ce n’était ni une chimère ni un état de grâce, mais un acte humain, humblement humain, par lequel on devenait ce que l’on était. Une disposition de l’esprit, une manière d’être que l’intelligence, le cœur et la volonté ne cessaient de nuancer et de réinventer jour après jour. » (p. 267)
La vie universitaire lui apportera quelques brèves consolations bien que là aussi, les conflits passionnés grèvent souvent sa tranquillité… William est un homme faible qui cherche seulement à s'abstraire d'une réalité inadaptée pour connaître quelques fulgurances libératrices.
Stoner nous offre le portrait émouvant d’un homme passionné pour qui la littérature sera le dernier espoir…
Ce que j’ai moins aimé :
Les passages dédiés à la littérature pure sont plutôt rares, même si la passion de cet homme pour son domaine demeure en filigrane tout au long du roman.
Premières phrases :
« William Stoner est entré à l’université du Missouri en 1910. Il avait dix-neuf ans. Huit ans plus tard, alors que la Première Guerre Mondiale faisait rage, il obtient son doctorat et accepte un poste d’assistant dans cette même université où il continuera d’enseigner jusqu’à sa mort en 1956. »
Vous aimerez aussi :
L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T. S. Spivet de Reif LARSEN
D’autres avis :
Presse : Télérama Sur le site du Dilettante
Blog : Papillon Antigone Kathel Théoma Nico
Stoner, John Williams, traduit de l’anglais (EU) par Anne Gavalda, Le Dilettante, août 2011, 384 p., 25 euros







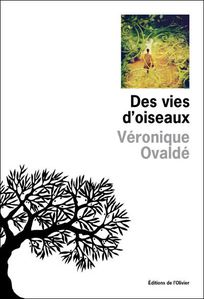

/image%2F0931533%2F20220803%2Fob_7cc6c0_1-9782253005230-1-75.jpg)
/image%2F0931533%2F20230626%2Fob_79b88a_266.jpg)

/image%2F0931533%2F20230713%2Fob_b2fb7d_9167er-606l-ac-uf1000-1000-ql80.jpg)



